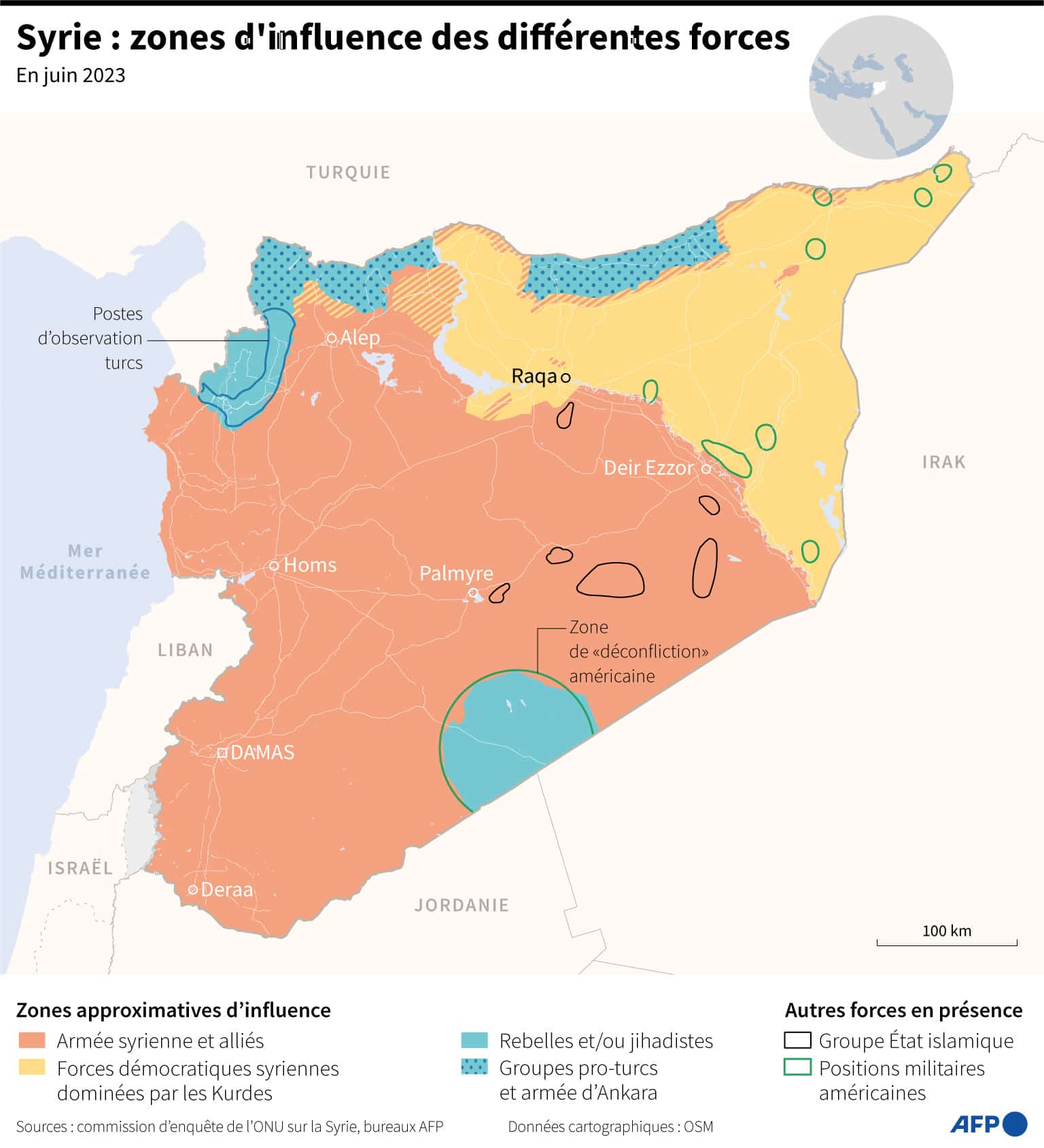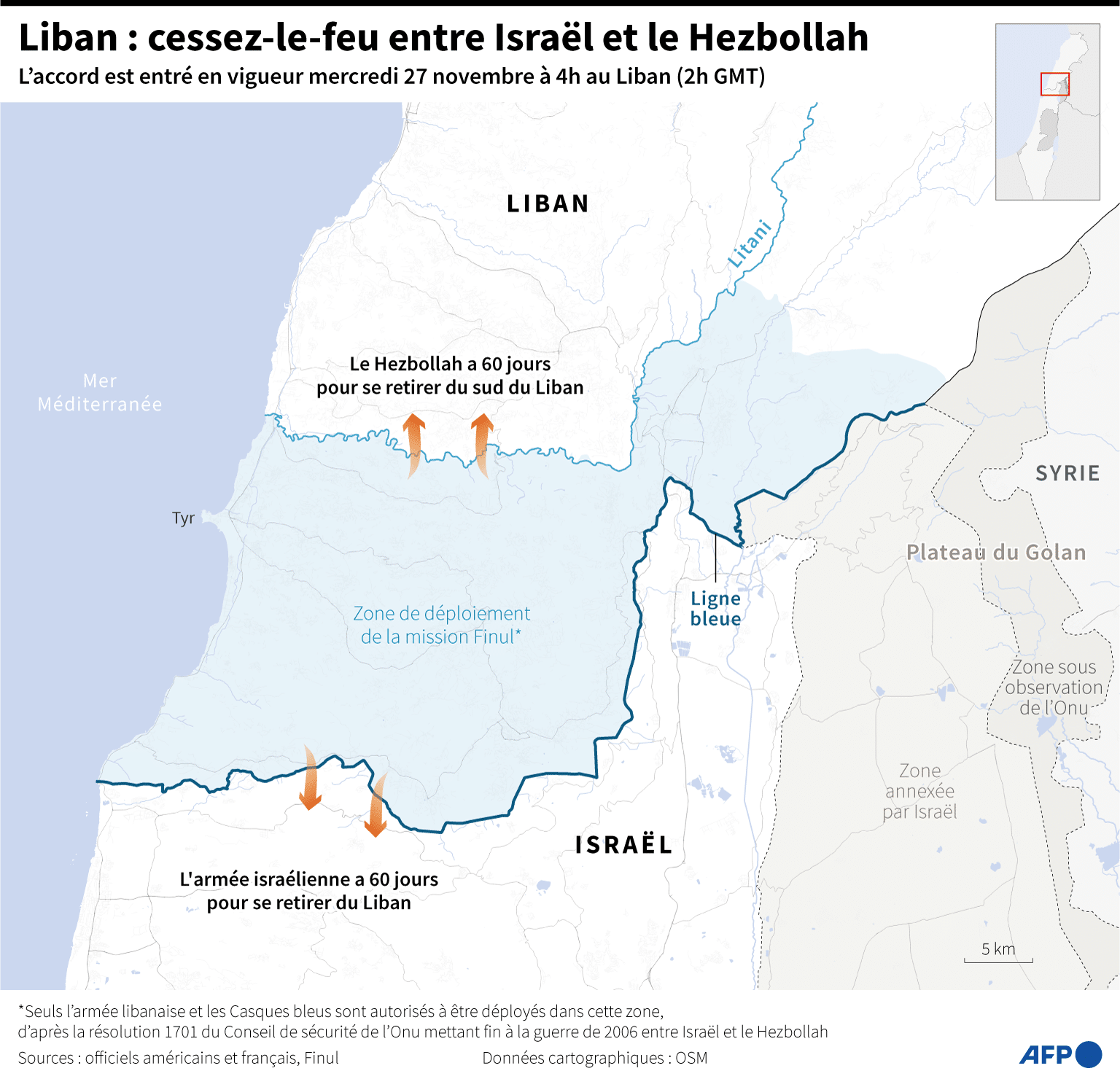Premier président américain depuis la chute de l’URSS à n’avoir pas même tenté d’amorcer un reset (remise à plat) avec la Russie, Joe Biden a malgré tout sauvé le New Start. L’extension pour cinq ans de ce traité russo-américain de réduction des armements stratégiques (New Strategic Arms Reduction Treaty) a été acceptée in extremis en février par les deux géants nucléaires.
Avec sa phobie des conventions internationales, Donald Trump ne voulait pas en entendre parler, contrairement à son successeur qui était vice-président lors de sa signature en 2010. Washington semble ainsi mettre un terme à la liste de ses récents renoncements – au traité international sur le nucléaire iranien (JCPOA) en 2018, au traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF) en 2019 ou au traité ciel ouvert en 2020 –, ce qui n’empêche pas Joe Biden d’adopter en parallèle un ton fort peu diplomatique à l’égard de Vladimir Poutine.
À l’image du duel médiatique entre Kim Jong-un et Donald Trump, la mise en avant de la personnalité des chefs d’État dans l’analyse de l’actualité internationale masque certaines dynamiques plus discrètes. Ainsi, la continuité au moins partielle entre les administrations Obama, Trump et aujourd’hui Biden peut sembler bien improbable si l’on s’arrête à une simple affaire de style. En matière de dissuasion nucléaire, mais aussi conventionnelle, les craintes américaines précèdent pourtant largement la politique menée par Donald Trump. Du côté de Washington, la première difficulté peut se résumer en une phrase : alors que les différents traités russo-américains structurent encore la relation entre les deux géants nucléaires de la guerre froide, cette architecture bâtie depuis un demi-siècle ne laisse-t-elle pas le champ libre à la Chine, dont les ambitions militaires ne sont pas affectées par ces dispositions juridiques contraignantes ? Donald Trump avait un mérite : il prononçait certes mal, mais au moins tout haut ce qui se disait ailleurs en des termes plus précis, mais mezzo voce. Ainsi n’hésita-t-il pas à assumer que les États-Unis n’avaient aucun intérêt à rester dans les traités New Start et INF si Pékin n’y adhérait pas. Sauf qu’il ne fait de mystère pour personne que la Chine n’accepterait jamais une telle « trilatéralisation » de ces traités. Alors, autant partir, résuma Donald Trump qui n’eut finalement le temps de ne venir à bout que du traité INF. Au grand, mais discret contentement de bien des responsables politiques américains pour qui ce dernier traité était le principal frein – bien plus que New Start – pour entamer vigoureusement leur pivot vers l’est et tenter de contenir Pékin.
À lire aussi : L’arme nucléaire est-elle encore utile ?
Un risque réel de prolifération
La seconde difficulté, qui ne concerne pas spécifiquement les États-Unis mais fragilise les traités de contrôle des armements, est le risque de prolifération sous une forme néanmoins renouvelée par rapport à la course connue jusqu’au pic de 1986 (69 368 ogives dans le monde contre environ 13 000 aujourd’hui). Le cas récent du Royaume-Uni, qui a décidé de porter le nombre de ses têtes nucléaires de 180 à 260, n’est pas le plus représentatif du mouvement actuel, qui porte davantage sur une diversification de vecteurs ayant souvent un usage dual (nucléaire ou conventionnel). On parle alors de prolifération qualitative au lieu d’une simple prolifération quantitative. Davantage que la seconde qui peut plus facilement faire l’objet de conventions la limitant, la première tend à s’auto-alimenter sans cesse, les Américains justifiant aujourd’hui la modernisation de leur arsenal en raison de celle menée par Moscou à partir du début des années 2000, elle-même justifiée par les projets annoncés par les Américains dans les années 1990. Or, les progrès actuels en matière de systèmes d’armes – que l’on subsume généralement sous le vocable un peu fourre-tout d’hypersonique – créent une dynamique similaire entre les États-Unis, la Russie et la Chine, marquée par une intrication croissante entre les dissuasions nucléaire et conventionnelle.
Les deux principaux traités russo-américains de contrôle des armements – le New Start et l’INF – ont été bâtis sur la distinction entre tactique et stratégie, cette dernière caractérisant depuis la guerre froide les armes capables d’atteindre la Russie depuis le territoire américain, et vice versa. Signé en 2010 pour prendre la relève des traités Start I et SORT, New Start limite à 700 le nombre de lanceurs nucléaires stratégiques – la triade formée des missiles intercontinentaux terrestres (ICBM), des missiles balistiques (SLBM) tirés depuis des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SSBN) et des bombardiers lourds – et à 1 550 le nombre de têtes nucléaires stratégiques déployées. À ce jour, Moscou comme Washington respectent officiellement les critères fixés. Signé en 1987, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) a quant à lui mis fin à la « crise des euromissiles ». Ce texte porte en réalité assez mal son nom dans la mesure où il interdit tous les missiles sol-sol d’une portée de 500 à 5 500 km, qu’ils soient nucléaires ou non. 5 500 km n’est pas un hasard : cette limite correspond, par convention, à la portée à partir de laquelle un missile est dit intercontinental. En interdisant les missiles intermédiaires, le traité INF s’avérait donc primordial dans la mesure où il revenait à garantir la distinction entre armes tactiques (moins de 500 km) et armes stratégiques (plus de 5 500 km) en établissant entre elles un vide de 5 000 km. À une nuance près, et non des moindres : seuls les missiles sol-sol étaient interdits par le traité INF ; ceux tirés depuis des navires demeuraient autorisés, exception dont allaient profiter pleinement les États-Unis, l’US Navy exerçant une domination alors incontestée. La dissuasion conventionnelle américaine s’est ainsi organisée à la toute fin de la guerre froide autour du couple formé par la dizaine de porte-avions nucléaires géants Nimitzet par les 80 destroyers Arleigh Burke et croiseurs Ticonderoga pouvant chacun emporter jusqu’à une centaine de missiles, dont des Tomahawks destinés à des frappes terrestres jusqu’à plus de 2 000 km. À l’image des bombardements contre la Serbie ou l’Irak, ce missile de croisière symbolisait la capacité de l’US Navy à pouvoir en quelques jours, voire en quelques heures, frapper de façon « chirurgicale » presque n’importe quel point du globe. Plus que la dissuasion nucléaire, la dissuasion conventionnelle devenait la marque de l’hyperpuissance américaine.
À lire aussi : Livre – La quête nucléaire de l’Iran
La question du bouclier antimissile
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Depuis trente ans, le bouclier antimissile américain est devenu le principal motif d’inquiétude des Russes comme des Chinois. Le projet tentaculaire de « guerre des étoiles » lancé par Ronald Reagan en 1983 a certes été abandonné, mais a malgré tout permis aux États-Unis de perfectionner, après la chute de l’URSS, leurs capacités antibalistiques. Il ne s’agissait plus alors de contrer des ICBM russes, mais des missiles de plus courte portée venant d’États dits voyous. Le 6 juin 2000 à Moscou, Bill Clinton expliquait ainsi au nouveau président Poutine : « Le bouclier antibalistique que nous allons construire en Europe de l’Est est seulement destiné à nous défendre contre les attaques d’États voyous et de groupes terroristes. Soyez donc rassurés : même si nous prenions l’initiative de vous attaquer par une première frappe nucléaire, vous pourriez aisément traverser le bouclier en question et anéantir notre pays, les États-Unis d’Amérique. »
Mais depuis lors, le scepticisme de la Russie, alimenté par son effondrement économique durant la décennie 1990, et celui de la Chine, nourri par le retard qu’elle possède encore en matière d’armes nucléaires, n’ont cessé de grandir et de les pousser à moderniser et à diversifier leurs arsenaux respectifs. Le bouclier antimissile américain, aujourd’hui opérationnel en Europe, repose sur le missile antibalistique SM-3, au départ conçu pour détruire des missiles de portée courte ou intermédiaire. Or, le 16 novembre 2020, un SM-3 Block IIA est parvenu lors d’une simulation à intercepter un ICBM. De quoi alerter Moscou et Pékin sur le fait que le bouclier n’était peut-être pas seulement destiné à contrer des rogue states, mais également des États légalement dotés de l’arme nucléaire. À cet égard, en 2002 – sans attendre Donald Trump ! –, les États-Unis avaient d’ailleurs quitté unilatéralement le traité russo-américain Anti-Ballistic Missile (ABM) de 1972, qui limitait très rigoureusement les « capacités défensives stratégiques » des deux États parties afin d’éviter d’affaiblir la dissuasion nucléaire.
C’est dans ce cadre conflictuel de longue date que la Russie a commencé dans les années 2000 à moderniser ses armements stratégiques, avec de nouveaux ICBM (Topol et demain Yars), de nouveaux sous-marins (Boreï) et leurs nouveaux SLBM (Boulava), de nouveaux bombardiers lourds Tu-160, ainsi que la mise au point de son propre système ABM (S-500). Les Russes ont aussi lancé de nouvelles armes stratégiques, révélées en 2018. Parmi celles-ci, figurent un drone torpille autonome à propulsion et à têtes nucléaires (Poseidon) destiné à frapper des villes côtières, ainsi qu’un planeur hypersonique (hyperglide vehicule en anglais), l’Avangard. Qu’il soit hypersonique n’a rien d’exceptionnel (les ICBM le sont déjà), mais le principe du planeur l’est davantage : ce type d’engins, d’abord propulsé par un simple missile, plane ensuite sur les couches hautes de l’atmosphère, dessinant une trajectoire plus complexe que celle d’un missile balistique, le rendant moins vulnérable. Les Américains, pourtant pionniers dans ce domaine, se sont fait doubler par les Russes, mais aussi par les Chinois.
Sur le strict plan de la dissuasion nucléaire, Pékin ne joue néanmoins pas dans la même cour, le pays possédant quelque 350 ogives déployées ou stockées (à comparer aux 3 800 américaines et 4 500 russes). À partir des années 1990, il lui fallut développer la technologie du mirvage (plusieurs têtes nucléaires sur un même missile). Et, en matière de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, Pékin est encore loin de Washington et Moscou, avec des bâtiments réputés peu discrets. Néanmoins, pour les trois piliers de sa triade, la Chine rattrape son retard sur le plan qualitatif plus que quantitatif, avec en particulier une nouvelle classe de SSBN (Type 095) qui renforcera sa capacité de seconde frappe. C’est aussi la raison pour laquelle Pékin attache autant d’importance à la mer de Chine méridionale, dont le relief sous-marin permet à ses SSBN basés sur l’île d’Hainan de se diluer discrètement. Demeurent les chiffres : la Chine reste loin des États-Unis et de la Russie. Raison pour laquelle, en 2018, lorsque Donald Trump avait voulu intégrer Pékin au traité New Start, le chef du département de contrôle des armements chinois, Fu Cong, avait déclaré non sans humour : « Je peux vous assurer que si les États-Unis sont prêts à revenir au niveau de la Chine, celle-ci sera heureuse de participer [à ces discussions] dès le lendemain. »
On comprend en creux que, dans le cadre de la rivalité systémique entre Pékin et Washington, le volet nucléaire de la dissuasion n’est pas la principale gageure pour les Américains, même si le sujet revient régulièrement. Au début de cette année, l’amiral Davidson, commandant de la zone Indo-Pacifique, a déclaré, alarmiste, que Pékin risquait d’égaler Washington en quadruplant son arsenal, ce qui est pour le moins inexact. Devant le Sénat, son successeur désigné, l’amiral Aquilino, l’a contredit dès le 23 mars. Ce débat est révélateur du dilemme auquel font face les Américains. Pour répondre aux modernisations des arsenaux russes et chinois, faut-il qu’ils dépensent des dizaines, voire des centaines de milliards pour concevoir un nouvel ICBM, un nouveau SLBM ou de nouvelles ogives ? Ou faut-il qu’ils changent leurs priorités, en abandonnant même l’un de leurs piliers, comme les ICBM qui risquent d’être la cible de futurs planeurs hypersoniques ? C’est l’un des paradoxes : alors même que la tension entre les États-Unis, la Russie et la Chine est à son comble, l’éventualité d’un tel abandon est soutenue par certains stratèges, dans une optique de désarmement, certes, mais surtout d’efficacité.
À lire aussi : Accord sur le nucléaire iranien. Les dessous militaires
L’enjeu maritime
« Pour éviter des crises et des conflits [dans l’Indo-Pacifique], la dissuasion conventionnelle est certainement le principal effort que j’identifie », a ainsi affirmé devant le Sénat l’amiral Aquilino. N’ayant pas été partie au traité INF, caduc depuis 2019, la Chine a massivement développé de tels systèmes d’armes dont la portée s’étend entre 500 et 5 500 km. Au-delà du fait que ses missiles balistiques DF-21 ou DF-26 pourraient avoir un usage dual, et donc emporter une charge nucléaire, l’enjeu est avant tout conventionnel, dans la mesure surtout où un missile comme le DF-26 dispose de capacités antinavires. Avec une portée de 4 000 km, il pourrait s’avérer être un redoutable carrier killer. En cas d’invasion de Taïwan par la Chine, les Américains prendront-ils le risque de voir envoyés par le fond des porte-avions dont le prix unitaire s’élève à plus de 10 milliards de dollars et qui accueillent chacun 5 000 marins ? Et ce sans compter que les Chinois ont aussi mis en service leur propre planeur hypersonique, le DF-17. Sa portée intermédiaire ne le range pas dans la catégorie des armes stratégiques, contrairement à l’Avangard russe, mais il pourrait s’avérer un terrible moyen de dissuasion à l’échelle indo-pacifique. « Les spécialistes chinois pensent que la conception occidentale de la dissuasion, qui repose principalement sur l’arme nucléaire, ne correspond pas à la réalité de la Chine. La force de dissuasion chinoise doit être fondée sur la force de dissuasion ‟générale” (zongti) », écrivait dès 2005 le chercheur Chen Shihmin dans un article de l’Institut de Stratégie comparée. Le développement exponentiel de la marine chinoise en donne une illustration des plus concrètes. D’ici à 2025, celle qui a l’ambition de devenir une marine de classe mondiale devrait compter une cinquantaine de destroyers et autant de frégates. Pour les Américains, le choc est donc très grand : la fraction peut-être la plus centrale de l’océan mondial leur échappe. Plutôt que d’investir dans le renouvellement de sa triade stratégique, Washington pourrait ainsi privilégier le déploiement de nouveaux missiles conventionnels sur le continent asiatique (à condition qu’ils trouvent des alliés acceptant un tel risque) pour combler cette nouvelle déclinaison du missile gap. D’ores et déjà, selon une étude récemment publiée par l’US Government Accountability Office, les différents projets d’armes hypersoniques voient leurs budgets exploser : à partir de 2020, plus de 2 milliards de dollars seront consacrés chaque année en recherche et en développement, contre 0,5 milliard jusqu’en 2017.
La dissuasion conventionnelle en Asie apparaît cruciale pour les États-Unis, dépassant par ses enjeux la raison officielle pour laquelle Washington s’est retiré du traité INF, à savoir le léger dépassement de la limite des 500 km par le système russe Iskander déployé notamment dans l’enclave de Kaliningrad. Que Moscou ait outrepassé cette portée est probable et symbolise la dégradation des relations russo-américaines sur ce front, la Russie accusant elle aussi depuis des années les Américains de contourner le traité INF. Car si l’OTAN assure que son bouclier antimissile ne peut pas servir à déployer des armes offensives contre Moscou, la réalité est moins évidente dans la mesure où les lanceurs Mk41 tirant les missiles SM-3 sont les mêmes qui permettent de tirer des missiles de croisière Tomahawk. Que la dissuasion conventionnelle russe ait fait des progrès ces dernières années ne fait aucun doute – à l’image du missile de croisière Zirkon, le premier hypersonique au monde – mais ce phénomène n’est en rien comparable par son ampleur avec le grand bond militaire chinois. Cette focalisation sur la Russie paralyse en revanche le continent européen dans sa recherche d’une autonomie stratégique, incompatible avec la croyance d’une Pax Americana indépassable.
Les débats récurrents sur l’obsolescence supposée de la dissuasion nucléaire sont donc très loin d’être tranchés. L’actualité nord-coréenne ou iranienne le montre d’ailleurs. Avec à nouveau, une grande incertitude : le JCPOA enterré par Donald Trump pourra-t-il renaître de ses cendres ? Biden parviendra-t-il à y adjoindre, comme son prédécesseur le souhaitait d’ailleurs, un volet balistique qui reviendrait à limiter également la dissuasion conventionnelle de l’Iran ? Quant à la Corée du Nord, elle illustre là encore l’importance extrême de cette dernière forme de dissuasion : avec Séoul à portée de son artillerie et le Japon de ses missiles à courte portée, Pyongyang s’est appuyée sur sa force conventionnelle pour dissuader les Américains de l’empêcher d’acquérir la « bombe ». À des échelles diverses, ces progrès de la dissuasion conventionnelle soulignent la fin de l’hyperpuissance américaine, comme un fil invisible qui relie les présidences Obama, Trump et Biden.
À lire aussi : La stratégie, de l’épée à la bombe atomique